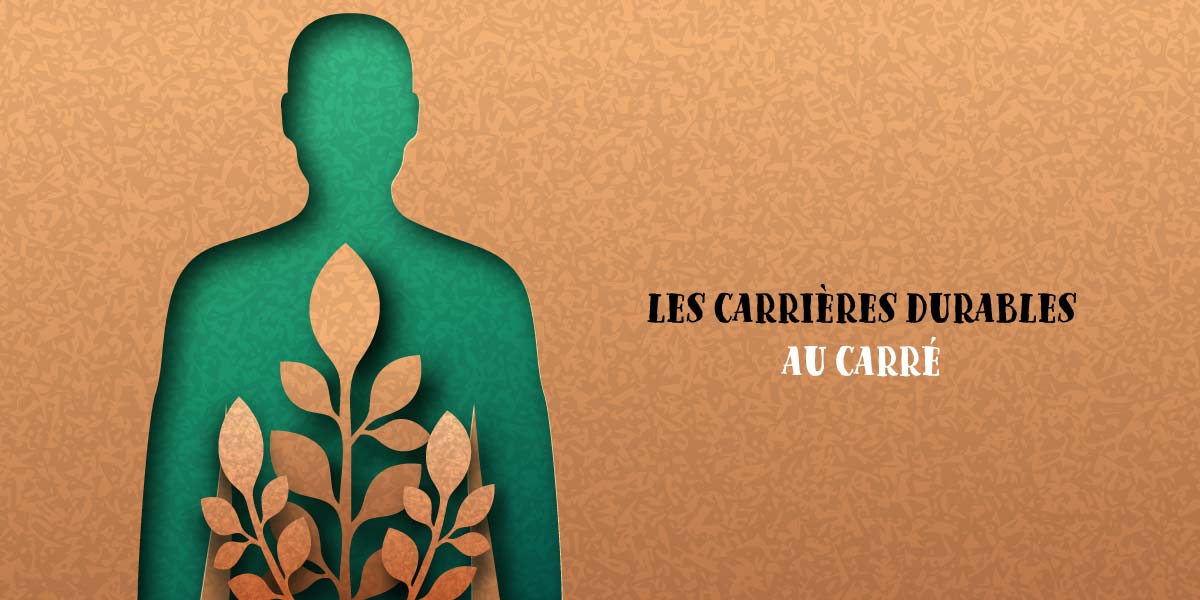Dans le contexte d’incertitude du travail et de l’emploi qui pousse chacun à se réinventer en permanence et à se comporter toujours davantage en entrepreneur pour gérer sa trajectoire personnelle et professionnelle, créer son œuvre en développant son esprit d’entreprendre permet de donner de la valeur à sa singularité et de capitaliser son engagement tout en se construisant une vie riche de sens.
Quête de sens et engagement dans l’action
Vivre une vie plaisante riche d’émotions agréables n’est pas suffisant pour mener sa vie avec satisfaction. Parce qu’il contribue activement à la construction du monde dans lequel il évolue, l’être humain éprouve un besoin fondamental de donner du sens à ce qu’il vit et à ce qu’il fait (1). Dans ce contexte, l’engagement volontaire dans une activité en lien avec ce qui est important pour soi, dans le but de réaliser quelque chose d’exigeant qui nécessite un dépassement de soi, est un moyen de créer du sens (2).
Ainsi, selon le célèbre psychiatre autrichien Viktor Frankl, l’engagement dans la réalisation d’une œuvre ou d’une bonne action constitue l’une des trois expériences, avec l’amour et la souffrance, susceptibles de répondre au besoin fondamental chez l’être humain de donner du sens à sa vie.
Cette question du sens revêt une importance grandissante dans le contexte d’incertitude de nos sociétés contemporaines. En effet, les systèmes qui structuraient autrefois la vie collective ont disparu et l’individu se retrouve seul face à ses choix (3). « Chacun, désormais indubitablement confronté à l’incertain, doit s’appuyer sur lui-même pour inventer sa vie, lui donner un sens et s’engager dans l’action » (4). Ce qui suppose qu’une fois renvoyé à lui-même et à la responsabilité de « sa propre réalisation », l’individu assume sa réussite comme son échec (5).
« Chacun, désormais indubitablement confronté à l’incertain, doit s’appuyer sur lui-même pour inventer sa vie, lui donner un sens et s’engager dans l’action ».
Ehrenberg (1995)
Si la sphère professionnelle n’est pas la seule dimension favorisant un engagement fort, elle est une source de construction de sens intéressante parce qu’elle propose des défis exigeants en termes de connaissances, de compétences et de concentration.
Sens, travail et économie à l’ère numérique
En prolongeant la troisième révolution débutée dans les années 1960 avec la naissance de l’informatique, la quatrième révolution industrielle fait se rencontrer les mondes physique, biologique et numérique. Sur le plan du travail et de l’emploi, de nombreux bouleversements touchant à la fois les individus et les organisations ont déjà eu lieu et vont se poursuivre grâce ou à cause des innovations technologiques et de la transformation numérique en particulier (voir par exemple 6 ; 7 ; 8).
Sur la toile mondiale, les modèles d’affaires des entreprises numériques favorisent par ailleurs un retour à une logique artisanale basée sur la personnalisation et un haut niveau de qualité tout en profitant des effets d’échelle. Aspirant à faire une oeuvre de leur travail, les individus de l’ère numérique ont déjà commencé à parcourir le chemin qui les sépare de la pratique de leur activité en tant qu’artisan, c’est-à-dire autonome, responsable et créative (9).
Ainsi, entre risques et opportunités, les questions demeurent nombreuses concernant le potentiel de ces technologies et du numérique en particulier en termes de création, de transformation, de déplacement et de destruction du travail et de l’emploi (10). Dans l’immédiat, il semblerait que la place centrale qu’occupe le travail chez les individus reste prépondérante (11).
Et d’ailleurs, l’ère numérique pourrait même obliger à redonner sa dimension humaine au travail. En effet, la prise en charge progressive par l’informatique de toutes les tâches programmables devrait amener à « concentrer le travail humain sur l’inprogrammable, c’est-à-dire sur la part du travail qui suppose liberté, créativité et attention à autrui, dont aucune machine ne semble être capable à l’heure actuelle » (12).
« Concentrer le travail humain sur l’inprogrammable, c’est-à-dire sur la part du travail qui suppose liberté, créativité et attention à autrui, dont aucune machine ne semble être capable à l’heure actuelle ».
Supiot (2019)
Dans un contexte de travail où créer devient essentiel, parallèlement à l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, la valeur ajoutée humaine reposera toujours davantage sur le développement des savoir-être, c’est-à-dire des compétences comportementales (soft skills) à même de faire la différence (13 ; 14).
Vers une hybridation de la carrière
La question du sens constitue désormais une composante centrale de l’accompagnement psychologique dans les domaines de l’orientation et du développement de la carrière (15). Dans cette perspective, l’approche du life design propose qu’en contexte d’incertitude, les préoccupations d’accompagnement se focalisent sur la construction de sens plutôt que sur le choix (16).
Dans la perspective plus vaste de la psychologie existentielle (17 ; 18), qui se préoccupe du rapport à l’existence, le sens du travail constitue une facette spécifique du sens de la vie et entretient avec ce dernier un lien étroit (19).
Sur le plan du développement et de la gestion de la carrière, la révolution numérique et les multiples transformations qui l’accompagnent changent le rapport des individus au travail et à l’entreprise. La carrière n’est plus ni linéaire, ni nécessairement ascendante, mais constituée d’un ensemble d’expériences professionnelles et de transitions multiformes. Si elle n’est déjà plus le fait de l’organisation et relève davantage d’un ajustement permanent effectué par l’individu sur la base de ses compétences, de ses aspirations et des opportunités du marché (20), la gestion de la carrière doit tenir compte des mutations de l’environnement actuel (21).
Si le salariat reste encore majoritaire, la tendance est à l’augmentation de l’activité indépendante. En réalité, on n’est désormais plus salarié OU indépendant. Les salariés sont aujourd’hui plus entreprenants dans leur entreprise. Face à une tendance à l’hybridation du travail salarié et du travail indépendant (22), l’individu est de plus en plus amené à développer un véritable état d’esprit d’entrepreneur pour construire sa trajectoire professionnelle. Et son souhait est d’exercer un travail qui a du sens pour lui (23).
Agir dans l’incertitude
L’entrepreneuriat n’est pas intéressant uniquement sur la dimension de création de valeur. Il l’est également en raison du lien étroit qu’entretiennent l’entrepreneur et son entreprise. S’investir dans la création de sa propre organisation peut être vu comme un moyen de redonner du sens à sa trajectoire professionnelle (24). L’entrepreneuriat constitue alors une opportunité d’alignement des croyances, des valeurs et des actions (25). Ainsi considéré, l’entrepreneuriat est infiniment plus qu’un projet économique puisqu’il est avant tout un projet de vie (26). En tant qu’il met à disposition un projet d’entreprise au service d’un projet d’entrepreneur, où l’entreprise devient un mode de réalisation des objectifs personnels et professionnels de l’entrepreneur (27), l’entrepreneuriat peut constituer une proposition de sens bienvenue dans le contexte d’incertitude actuel. Ceci même si, paradoxalement, l’incertitude elle-même est une condition ordinaire de l’expérience entrepreneuriale (28).
Projet entrepreneurial particulier, les startups technologiques se définissent précisément par l’incertitude. Contemporaines des préoccupations de sens de nos sociétés et l’expression d’un monde en changement permanent, elles opèrent dans des secteurs émergents et instables où elles connaissent une faible inertie étant donné l’impossibilité de s’appuyer sur des activités existantes (29). Dans ce contexte, l’agir dans l’incertitude des entrepreneurs technologiques semble constituer un éclairage pertinent pour des individus amenés à se comporter toujours davantage en entrepreneur dans la gestion de leur trajectoire personnelle et professionnelle.
Or, il semble que ces entrepreneurs construisent, dans l’environnement incertain de leur startup, quelque chose de l’ordre d’une ressource psychologique propre à les amener à se dépasser et à faire face aux vicissitudes de l’aventure entrepreneuriale. Ce n’est pas la création de la startup en soi qui compte, mais la possibilité qu’elle offre de porter leurs aspirations. Les motifs de ces entrepreneurs sont divers, comme par exemple créer de la valeur économique, exercer un impact, vivre une expérience de développement personnel ou créer un environnement de travail qui correspond à leurs propres besoins, mais l’invariant qui sous-tend leur expérience entrepreneuriale semble relever du souhait d’inscrire leurs actions dans la continuité, dans quelque chose de plus vaste qui les prolonge et les dépasse.
Entreprendre pour créer son œuvre
En fait, ces entrepreneurs font bien plus qu’entreprendre, ils créent leur œuvre. Et comme pour l’artiste créateur (30), parvenir au terme de leur entreprise et conformément à leur souhait n’est jamais une certitude. Ainsi, « l’incertitude se niche au cœur même de l’acte de création […] et c’est bien l’épreuve de l’incertitude qui donne son épaisseur d’humanité et ses satisfactions les plus hautes au travail créateur ». En permettant la création d’une œuvre, le travail devient source d’épanouissement et de réalisation de soi (31). Ceci parce que l’homme ne travaille pas pour passer le temps, il travaille pour construire et l’ensemble de ses conduites aboutissent à des œuvres (32).
La dimension de création d’une œuvre qui se niche au coeur de l’expérience entrepreneuriale renvoie aux travaux sur l’engagement dans la réalisation d’une œuvre de Viktor Frankl (1). Partant, l’expérience entrepreneuriale contribuerait au moins autant au sens de la vie qu’au sens du travail. Une interprétation dans la perspective existentialiste renvoie au thème de l’immortalité symbolique (33) où l’œuvre offre à son créateur de transcender sa finitude en inscrivant sa trace dans le monde.
Ce qui semble distinguer ces entrepreneurs et constituer leur force, c’est le sentiment que ces hommes et ces femmes ont de construire quelque chose de personnel dans lequel ils capitalisent leur engagement. Ce qui, en soi, compose une récompense singulière et particulièrement précieuse dans le contexte d’incertitude du travail et de l’emploi qui pousse chacun à la réinvention permanente. En offrant l’opportunité de s’engager dans la création d’une œuvre, les expériences de création dans le champ professionnel composent une source précieuse de création de sens et de valeur. A ce titre, créer une œuvre dépasse le seul cadre de l’entrepreneuriat et des startups et ouvre sur un vaste champ de possibles.
Développez votre esprit d’entreprendre et agissez !
Etre créateur d’entreprise, ou ne pas l’être, n’est pas la préoccupation. Dans un tel contexte, la question tourne davantage autour de la capacité à développer et à mettre à profit ce qui s’apparente à une disposition d’esprit. Plus que l’entrepreneuriat lui-même, c’est l’esprit d’entreprendre, qui sous-tend les comportements de l’entrepreneur, qui est central. Chacun devrait pouvoir doser le niveau entrepreneurial qui correspond à ses besoins et convient à son activité.
Lʼœuvre concerne potentiellement tout individu à même de proposer de la valeur sur un marché spécifique, même restreint. Ainsi, que vous ayez déjà passé à l’action, que vous vous apprêtiez à le faire, ou encore que vous rêviez de le faire. Que vous vouliez créer une entreprise, une startup, développer votre activité indépendante, artistique ou artisanale, ou que vous vouliez créer et innover dans l’entreprise qui vous emploie déjà sous la forme de projets ou d’intrapreneuriat, créer votre œuvre c’est construire quelque chose de personnel dans lequel capitaliser votre engagement.
Le contexte d’incertitude du travail et de l’emploi qui pousse chacun à la réinvention permanente peut être abordé comme une opportunité. Demandez-vous ce que vous pouvez faire et pour qui vous pouvez le faire en fonction de votre configuration unique d’expériences, de connaissances et de compétences. Identifiez votre spécificité, développez votre esprit d’entreprendre et valorisez votre singularité.
Construisez une vie riche de sens, créez votre œuvre.
Stéphane Bonzon
Références
(1) Frankl, V. (2009). Nos raisons de vivre. À l’école du sens de la vie. Paris : InterEditionsDunod.
(2) Lecomte, J. (2006). Donner un sens à sa vie. Odile Jacob.
(3) Aubert, N. (2006). L’intensité de soi. In L’individu hypermoderne (pp. 73-87). Erès.
(4) Ehrenberg, A. (1995). L’individu incertain. Calmann-Lévy.
(5) De Gaulejac, V. (2006). Le sujet manqué. In L’individu hypermoderne (pp. 129-143). Erès.
(6) Rifkin, J. (1996). La fin du travail. Paris, La Découverte.
(7) Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age : Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.
(8) Colin, N., & Verdier, H. (2015). L’âge de la multitude-2e éd.: Entreprendre et gouverner après la révolution numérique. Armand Colin.
(9) Vitaud, L. (2019). Du labeur à l’ouvrage. Calmann-Lévy.
(10) Degryse, C. (2016). Impacts sociaux de la digitalisation de l’économie. WP Etui, 1-86.
(11) Valenduc, G., & Vendramin, P. (2016). Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. ETUI, Institut Syndical Européen, WP.
(12) Supiot, A. (2019). Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle. Collège de France.
(13) Newport, C. (2016). Deep work: Rules for focused success in a distracted world. Hachette UK.
(14) Evéquoz, G. (2019). La carrière professionnelle 4.0 : tendances et opportunités. Genève : Slatkine.
(15) Bernaud, J. L. (2016). Le « sens de la vie » comme paradigme pour le conseil en orientation. Psychologie française, 61(1), 61-72.
(16) Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., … & Bigeon, C. (2010). Construire sa vie (Life designing) : un paradigme pour l’orientation au 21e siècle. L’orientation scolaire et professionnelle, (39/1), 5-39.
(17) Bernaud, J. L., Lhotellier, L., Sovet, L., Arnoux-Nicolas, C., & Pelayo, F. (2015). Psychologie de L’accompagnement : Concepts et Outils pour Développer le Sens de la vie et du Travail. Paris : Dunod.
(18) Bernaud, J.L. (2018). Introduction à la psychologie existentielle. Paris : Dunod.
(19) Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work : The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337.
(20) Hall, D. T. (1996). Protean careers of the 21st century. Academy of Management Perspectives, 10(4), 8-16.
(21) Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). Introduction: The boundaryless career as a new employment principle. The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, 3-20.
(22) Coste, J. H. (2018). À la lisière de deux mondes: l’entrepreneur «hybride». Entreprendre Innover, (2), 36-54.
(23) Dik, B. J., Duffy, R. D., Allan, B. A., O’Donnell, M. B., Shim, Y., & Steger, M. F. (2015). Purpose and meaning in career development applications. The Counseling Psychologist, 43(4), 558-585.
(24) Hernandez, E. M. (2006). Extension du domaine de l’entrepreneur… et limites. La Revue des sciences de gestion, 3, 17-26.
(25) Brasseur, M. (2012). L’entrepreneuriat des seniors comme quête existentielle. Revue française de gestion, 8, 81-94.
(26) Bruyat, C. (1993). Création d’entreprise : contributions épistémologiques et modélisation (Doctoral dissertation, Université Pierre Mendès-France-Grenoble II).
(27) Fonrouge, C. (2002). L’entrepreneur et son entreprise: une relations dialogique. Revue française de gestion, 28(138), 145-158.
(28) Valéau, P. (2006). L’accompagnement des entrepreneurs durant les périodes de doute. Revue de l’Entrepreneuriat, 5(1), 31-57.
(29) Monsted, M. (2000). L’incertitude, source de risque et d’opportunités en high tech. In Les start-up high tech – Création et développement des entreprises technologiques (pp. 15-24).
(30) Menger, P. M. (2009). Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain.
(31) Thévenet, M. (2011). Enchanter le travail. Transversalites, (4), 39-57.
(32) Meyerson, I. (1949). VI.-Comportement, travail, expérience, oeuvre. L’Année psychologique, 50(1), 77-82.
(33) Lifton, R. J. (1971). Protean man. Archives of general psychiatry, 24(4), 298-304.